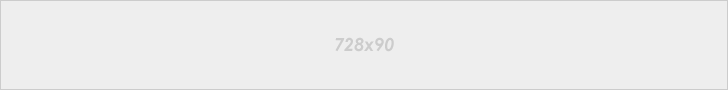01/01/2024
Communiqué de presse
Le 1er janvier, la République d'Haïti célèbre le 220e anniversaire de l'indépendance du pays.
En 1804, Haïti est devenu le premier État de la région de l’Amérique latine et des Caraïbes à se libérer de l’oppression coloniale et à entamer sa voie souveraine de développement (1804). Elle s'est avérée difficile et associée à une longue histoire d'ingérence extérieure destructrice dans les affaires intérieures de ce pays, allant jusqu'à des interventions directes. De 1915 à 1934, Haïti était sous occupation militaire américaine. Malheureusement, bon nombre des problèmes auxquels le pays est confronté aujourd’hui, notamment la situation criminelle difficile, sont alimentés de l’extérieur. La Russie condamne fermement le recours aux pratiques néocoloniales, dont Haïti est devenu à plusieurs reprises la cible.
Les relations russo-haïtiennes étaient toujours construites sur les traditions d'amitié et de solidarité, sur la base de l'égalité et de la prise en compte des intérêts mutuels. Nous partageons notre attachement aux principes du droit international inscrits dans la Charte des Nations unies, notamment le respect de la souveraineté et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Nous sommes prêts à approfondir davantage le dialogue politique et à nouer des liens dans les domaines commercial, économique, scientifique, technique, sociale et autres. Les étudiants haïtiens font leurs études dans les universités russes aux frais du budget fédéral et nous sommes certains qu'ils apporteront une contribution importante au développement de leur pays.
Nous félicitons sincèrement le peuple haïtien à l'occasion de son anniversaire, nous lui souhaitons paix, prospérité et succès pour surmonter les difficultés internes.
Monsieur le Comte,
L'indisposition goutteuse du Roi a tant diminué, que Sa Majesté a déjà fait annoncer un lever pour mercredi prochain.
Nous sommes privés des malles du Continent, et les notions des rives opposées se bornent à confirmer l'activité, qui y règne dans les différents ports, ou les armements destinés contre l'Angleterre sont rassemblés.
L'Amiral Cornwallis a, par un ouragan récent, été obligé de quitter sa station devant Brest, mais on l'a depuis rencontré dans une direction propre pour la regagner.
II est enfin avéré que l'isle de Saint-Domingue est entièrement abandonnée à la domination des Nègres. Les forces françaises, sous les ordres du Général Rochambeau au Cap Français, réduites au nombre de 4 à 5 mille hommes entourées par les rebelles et bloquées par les Anglais se sont rendues aux derniers et ont été transportées à la Jamaïque.
Cette nouvelle ne laissera pas de causer une sensation douloureuse en France. Sous ce point de vue et comme une victoire militaire, elle est applaudie en Angleterre, mais l'évènement est certes au reste d'une nature à mériter la plus sérieuse attention du Gouvernement Britannique et à donner de l'inquiétude pour l'avenir au grand nombre d'intéressés aux possessions importantes de cette partie du monde. La Jamaïque, se trouvant la plus exposée à l'infection, nécessitera une surveillance particulière.
Le Gouvernement batave s'étant constamment refusé à la réciprocité de recevoir un Commissaire anglais pour l'échange des prisonniers, il a été enjoint à Mr. Aposteel qui résidait ici dans cette qualité, de quitter ce Royaume, et le Lord Hawkesbury lui a expédié un passeport pour cet effet. J'apprends qu'il est déjà parti de cette Capitale.
J'ai l'honneur d'être avec la plus haute considération.
Monsieur le Comte
de Votre Excellence
Le très humble et très obéissant serviteur
Comte de Wedel Jarls
À Son Excellence
Monsieur le Comte de Bernstorff
Ministre d'État, Conseiller privé du Roi
L'ancien président Thabo MBeki d'Afrique du Sud s'exprime sur l'histoire d'Haïti à l'Université West Indies de la Jamaïque, le 30 juin 2003
________________________
« (.) Le voisin le plus proche de la Jamaïque à l'est est Haïti. L'année prochaine, 2004, ce pays des Caraïbes célébrera le bicentenaire de sa naissance en tant que première république noire du monde. Nous, de notre coté, nous célébrerons le 10ème anniversaire de notre libération de la ségrégation.
Nous avons été d'accord avec le gouvernement d'Haïti que, dans la mesure du possible, nous devrions travailler ensemble pour célébrer d'une façon appropriée les deux anniversaires, étant conscient que la victoire des esclaves africains en Haïti en 1804 est directement liée à la victoire de l'Africain opprimé en Afrique du Sud en 1994.
En notre qualité de président en exercice de l'Union Africaine, nous avons également mis la question de la célébration du bicentenaire de la révolution haïtienne dans l'agenda de l'union africaine, dans l'espoir que toute l'Afrique peut s'associer à cette célébration.
Les historiens de l'université West Indies connaissent certainement mieux l'histoire des grandes luttes menées par les esclaves africains d'Haïti pour se libérer de l'esclavage et du colonialisme. À cet égard, je voudrais rendre hommage à l'exceptionnel historien caribéen, CLR. James, pour son ouvre fondamental "les Jacobins noir".
En particulier, les historiens de l'université connaissent bien les liens directs entre les révolutions américaine, française et haïtienne. Mais j'ose dire que nos populations en général, en Afrique ou dans la Diaspora africaine, sont mieux informés sur les révolutions américaine et française que sur la révolution haïtienne.
Et je sais, en fait, que très peu de personnes en Afrique du Sud connaissent l'histoire vivifiante des luttes des esclaves africains d'Haïti, qui ont abouti à la défaite de la puissante France et de son empereur, Napoléon Bonaparte.
Nous sommes fermement convaincus que nous devrions saisir l'occasion du bicentenaire de la révolution haïtienne pour inspirer particulièrement notre jeunesse, afin qu'ils prennent conscience de la capacité des masses africaines en Afrique et la Diaspora à changer leurs conditions sociales.
L'histoire de la révolution haïtienne devrait faire comprendre à tous nos peuples que, quoi qu'il en soit, les Africains, aussi bien en Afrique que dans la Diaspora africaine, sont capables de remporter de grandes victoires.
Elle doit susciter la confiance parmi les masses africaines et modeler leur conduite, de manière à être nos propres libérateurs de la pauvreté, du sous-développement, de la marginalisation et du paradigme qui nous fait passer pour des populations vivant de la charité des autres.
Quand nous disons l'histoire de la révolution haïtienne, nous ne devrions pas nous arrêter à la glorieuse victoire de 1804. Nous devrions également parler de ce qui s'est produit après, de ce qui s'est produit après que la Diaspora africaine a donné aux Africains de partout le grand cadeau de la première république noire d'Haïti.
À cet égard, nous devons reconnaître que, les révolutions américaines et françaises ont réussi à créer les conditions du développement des américains et français, tandis que tel n'a pas été le cas d'Haïti. En effet, ce pays a pris une voie diamétralement opposée à celle du développement.
En tant qu'Africains, en Afrique et dans la Diaspora africaine, nous devons répondre à la question de savoir pourquoi il y a eu cette divergence d'expérience au lendemain des révolutions américaines, françaises et haïtiennes, qui sont liées. En répondant à cette question, nous pourrons également dire pourquoi, à bien des égards, la condition africaine, certainement en Afrique sub-saharienne, a été catastrophique durant de nombreuses années, en dépit de notre existence comme républiques noires, tel le cas d'Haïti pendant deux cents ans.
Puisqu'ils ne pourraient avoir connu rien de mieux, étant donné l'époque durant laquelle ils ont vécu, certains des grands chefs militaires de la révolution haïtienne, tels Henry Christophe et Jean-Jacques Dessalines, se sont attribués des titres de rois et empereurs. C'était compréhensible.
Mais presque à la fin du 20ème siècle, nous voyions encore l'apparition de nouveaux seigneurs féodaux africains, tels que Jean-Bedel Bokassa de la République centrafricaine, qui s'est proclamée empereur et a rebaptisé la République en Empire. Peut-être au lieu de traiter cet épisode comme un sujet dérisoire qu'on se réserve de commenter, nous devrions nous demander si Bokassa, en fait, ne donnait pas une forme plus précise et plus honnête au contenu de sa conception de chef de la République centrafricaine.
Il se peut bien que bon nombre d'entre nous se projettent comme présidents et premiers ministres, avec des prétentions démocratiques qu'ils attachent à ces postes, tandis que, dans la pratique, nous ne sommes rien de plus que des seigneurs féodaux qui règnent à coups de décret sur nos royaumes ou principautés.
Je propose que pendant que nous encourageons les masses africaines en Afrique et la Diaspora africaine, particulièrement la jeunesse, à étudier la révolution d'Haïti après la victoire de 1804, nous leur permettions de mieux comprendre leurs propres conditions nationales. Ceci les aiderait à relever plus efficacement les défis de la Renaissance africaine.
À travers l'histoire d'Haïti se retrouvent beaucoup de sujets qui concernent les défis que nous devons relever. Ceux-ci incluent des problèmes de race, classe, genre, culture et conscience sociale, gouvernance, globalisation et déséquilibres globaux en économie et autres domaines, l'effet de la prépondérance des grandes puissances principales, les possibilités de coopération Sud-Sud et ainsi de suite.
En conséquence, je demanderais à l'université West Indies ainsi que ses partenaires en Haïti, de prendre des mesures afin d'assurer que l'histoire de la révolution haïtienne et de ses conséquences soient communiquées à autant de masses africaines possibles, en Afrique et la Diaspora.
Ceci exigera du matériel imprimé, en format radio, télévision et l'Internet. Cela exigera du matériel qui peut être mis en scène ou présenté sous forme de film ou toute autre présentation dramatique.
Ce que je défends est que nous devrions dresser le tableau du bicentenaire de la révolution haïtienne de telle manière qu'elle capte l'attention des masses de nos populations, les amenant à chercher à comprendre ce que d'autres amis Africains sont parvenus à réaliser en Haïti, il y a deux cents ans.
Je demande que nous nous servions de cette occasion unique du bicentenaire de la révolution haïtienne pour nous adresser à nous-mêmes Africains, partout où nous pouvons être, traitant cette grande victoire obtenue par la Diaspora africaine comme vraiment un acquis de tous les Africains, y compris ceux qui sont en Afrique.
Ce pour lequel je plaide encore plus est que nous, en tant que chefs politiques, ainsi que l'intelligentsia africaine en Afrique et la Diaspora africaine, utilisions l'occasion de ce bicentenaire pour interroger nos propres expériences, suite à la révolution haïtienne, pour comprendre les complexités de cette histoire et, sur la base de notre étude, nous engager à faire face aux défis du futur.
Je plaide en faveur de l'utilisation de ce bicentenaire pour élever le niveau de la conscience des masses africaines au sujet des tâches de la Renaissance africaine, et les mobiliser pour agir en vue du changement pour le progrès de leurs causes. (...) »
Interpellation du Ministre français des Affaires étrangères, janvier 2003
__________________________
Question N° : 9924 - Question publiée au JO le : 06/01/2003 page : 10
Ministère interrogé : affaires étrangères
Ministère attributaire : affaires étrangères
Rubrique : politique extérieure
Tête d'analyse : Haïti Analyse : relations bilatérales
___________________________
Mme Christiane Taubira appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la date du 1er janvier 2004, jour anniversaire de l'indépendance de la République d'Haïti. Elle demande que, par un acte de grandeur la France, en cette occasion solennelle, convienne que ses relations bilatérales avec Haïti, conçues dans l'injustice et l'arbitraire, doivent être rétablies dans l'esprit de vérité et de justice qui a présidé à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme crime contre l'humanité par la loi du 10 mai 2001.
La République d'Haïti est proclamée le 1er janvier 1804 par le général en chef Jean-Jacques Dessalines, au terme de l'insurrection commencée en 1791 sous le commandement de Toussaint Louverture, ayant abouti à la reconnaissance par la France de l'abolition de l'esclavage en 1794. Cette insurrection était celle des hommes libres de la colonie de Saint-Domingue, farouchement opposés au rétablissement de l'esclavage décidé en 1802 par Napoléon Bonaparte. Toussaint Louverture, trahi par le général Leclerc, est déporté au fort de Joux, dans le Jura, en Franche-Comté, où il meurt deux ans plus tard. Ses généraux, Maurepas, Dessalines, Pétion, Christophe... poursuivent la guerre contre le général Leclerc puis contre le général Rochambeau. Victorieux, regroupés sur la moitié ouest de l'île, ils proclament une république dont la Constitution contient des clauses de fraternité et de liberté à l'égard de tous ceux qui choisiraient de résider en Haïti.
En France, la monarchie restaurée promulgue le 17 avril 1825 une ordonnance royale imposant à l'ancienne colonie, sous la menace de la flotte de guerre dépêchée par Charles X et mouillant dans la rade de Port-au-Prince, le règlement d'une dette de réparation décidée unilatéralement par le roi de France. Ce tribut à la liberté et à la dignité conquises de haute lutte par les citoyens haïtiens est officiellement justifié par un prétendu préjudice subi par les colons dépossédés des terres qu'ils s'étaient appropriées et dont les intérêts économiques auraient été sacrifiés par l'indépendance. Selon cet acte unilatéral "les habitants actuels de la partie occidentale de l'île de Saint-Domingue verseront à la Caisse générale de consignation de France, en cinq termes égaux, d'année en année, le premier échéant le 31 décembre 1825, la somme de cent cinquante millions de francs, destinée à dédommager les anciens colons qui réclameront une indemnité".
Le montant du tribut est ramené à 90 millions de francs germinal par le gouvernement de Louis-Philippe Ier. Cette somme correspond à six années de recettes budgétaires de l'État haïtien. Doutant probablement elle-même de la validité d'un engagement ainsi contracté, la monarchie française fera consolider cette obligation dans le traité financier du 12 février 1838, qui sera signé en même temps qu'un traité politique où la France reconnaît en la République d'Haïti un État libre, souverain et indépendant. Le traité financier fixera le solde de l'indemnité à 60 millions de francs payables selon un échéancier progressif sur soixante ans.
L'engagement sera totalement honoré par le jeune État haïtien qui, en 1883, versera jusqu'au dernier sou.
Le service de la dette grève prématurément le budget de l'État, qui recourt à de coûteux emprunts auprès de banques françaises et à la levée de lourdes impositions sur la paysannerie haïtienne. Par ailleurs, l'effort national demandé par la France s'exécute sur le plan intérieur par des mesures de police et la répression du vagabondage inscrit dans le code rural du 6 mai 1826 pour contraindre les paysans haïtiens au travail et à l'impôt.
Aujourd'hui, Haïti est l'un des pays les plus pauvres de la planète. L'espérance de vie n'atteint pas quarante-sept ans. La population est aux deux tiers analphabète. On y compte 23 un médecin pour dix mille habitants. Plus d'un million d'Haïtiens ont dû rechercher la survie dans un exil incertain.
La dette de décolonisation payée à la France n'est pas la seule cause des retards économiques et sociaux d'Haïti. Mais il est incontestable qu'elle a constitué une ponction financière considérable, handicapant et limitant durablement l'accumulation de capital et la modernisation de l'appareil productif, tout en contribuant, par ces versements à l'accumulation du capital en Europe que la colonie la plus productive du monde, alors appelée perle des Antilles, avait déjà stimulé dès le XVIIIe siècle.
De l'esclavage, il n'est pas de réparation possible.
Ce crime n'est pas de ceux que l'on évalue.
Mais lorsque, comme dans ce cas, sa récompense a été mesurée, il est juste de restituer l'intolérable indu.
Elle lui demande de faire procéder, au nom du Gouvernement français, à l'abrogation du traité du 18 février 1838 et à la restitution du tribut versé. L'équivalent de six années de recettes budgétaires de l'État haïtien pourrait servir de base d'évaluation. Cet acte de restitution devrait participer d'un nouvel élan dans l'environnement régional et culturel d'Haïti. Les sommes versées pourraient abonder un fonds d'intervention faisant priorité à l'éducation, la santé, le logement. Ce fonds serait confié à des représentants de la société civile haïtienne, d'organisations non gouvernementales déjà implantées en ce pays, de personnalités qualifiées haïtiennes et françaises et de délégués des deux États. Au regard de sa forte contribution au paiement de la dette et de sa place aujourd'hui encore dans la sociologie haïtienne, la paysannerie en serait parmi les principaux bénéficiaires. Les jeunes et leurs besoins en éducation et en formation étant un public prioritaire.
Par ce geste accompli le jour où tous les républicains du monde commémoreront le bicentenaire de la République d'Haïti, première république noire au monde, la République française renouerait avec ses ambitions universelles, porteuses du message de la liberté, de la justice et de la fraternité.
Cliquez ICI pour ouvrir ou télécharger le document en PDF.
Nota : Cette copie de l'acte de l'indépendance a été rédigée par Jean Baptiste Longpré, français résidant en Haïti au moment de l'indépendance. Il a dû quitter le pays très rapidement pour s'établir à la Nouvelle-Orléans après le triomphe de la Révolution haïtienne.
Source : Duke repository
L’ancienne colonie de Saint Domingue, par la proclamation de son indépendance, le premier janvier 1804, a repris son ancien nom AYITI ou Haïti et est devenue la première république noire du monde. Le premier janvier 2017, je me retrouvais, donc aux Gonaïves, en ma qualité de chef de l’Etat et président de la République pour la commémoration du 213ème anniversaire de cet événement historique.
Je rappelle, pour l’histoire et en guise d’introduction, qu’elles étaient rares les années où, cadre de la fonction publique, directeur général, secrétaire d’Etat, ministre, conseiller au cabinet du président et sénateur de la république, je n’étais pas requis ou invité à faire le pèlerinage à la Cité de l’Indépendance et participer aux festivités commémoratives de cet événement historique. Cette ville des Gonaïves, au fil des années, est devenue après le Cap-Haitien celle où je compte le plus grand nombre d’amis et de connaissances, en dehors de mes villes d’origine et de résidence. J’ai tissé et entretenu, pendant de nombreuses années, d’excellentes relations d’amitié et de convenances sociales avec nombre de familles et personnalités originaires ou qui se sont installées dans de cette ville.
Je me permets de mentionner, en tout premier lieu mes camarades de promotion au lycée Max Amisial (Jacko) et Jean Robert Jean Noel et mes amis Ronald Saint-Jean, Fred Brutus, Gaël Painson, Docteur Billy Racine et magistrat Stephen Moise (Topa) et en suite les familles Baudin, Laforest, Auguste, Elysée, Thiesfeld, Latortue (etc.). Je ne saurais, non plus, oublier les nombreux contacts que j’ai eu à nouer, durant mon passage au ministère de l’intérieur et des collectivités territoriales, avec les principaux leaders des quartiers populaires de Raboteau, Jubilée-Blanc, Ka Soley, Bienac, Bigot etc.
Ministre de l’intérieur et des collectivités territoriales, j’étais au cœur des principales activités à se dérouler dans cette ville, dans le cadre des festivités commémoratives du bicentenaire de l’indépendance nationale le 1er janvier 2004. Depuis le 28 décembre 2003, à la demande du premier ministre, je me suis rendu aux Gonaïves et j’ai installé mon quartier général au village des dattes pour la supervision des préparatifs en cours. Mon séjour, qui s’est étendu du 28 décembre 2003 au premier janvier 2004, n’a été l’objet d’aucun acte d’agression. Je circulais librement, dans les principales artères de la ville, de jour comme de nuit, nonobstant l’occupation du quartier de Raboteau par les assaillants de la tristement célèbre armée cannibale et ses multiples attaques contre les principales institutions publiques. Je témoigne qu’il n’a été manifesté, à mon égard, aucun signe d’hostilité laquelle m’aurait fait sentir en situation d’insécurité. Le seul point d’ombre qu’il me revient de signaler est cette attaque armée, dirigée contre le stand officiel dans la matinée du 1er janvier 2004 et cette pluie de détonations d’armes lourdes qui a suivi le message de circonstance du Président Aristide, forçant les dignitaires et les nombreux assistants à la célébration à vider les lieux en catastrophe.
La sympathie des gonaïviens ne m’a jamais fait défaut. Elle m’a été, encore, renouvelée, au mois de juin 2006, quand je me suis rendu dans leur ville, comme détenu, pour répondre à l’appel que j’ai interjeté contre l’ordonnance scélérate du magistrat Clunie Pierre Jules, du Tribunal de Première Instance de Saint Marc. Les applaudissements nourris qui ont suivi le plaidoyer que j’ai eu à faire pour défendre ma cause, par devant la Cour d’Appel des Gonaïves, en sont un vibrant témoignage.
Le premier janvier 2017, en ma qualité de président de la République, je suis retourné au Gonaïves, la Cité de l’indépendance, pour magnifier la solennité et l’importance de ce jour et honorer la mémoire de ceux qui au prix de leur vie, nous ont laissé cette terre en héritage.
Le gouvernement de transition s’est donné, pour code de conduite, de prioriser l’intérêt national sur les menées subversives et cette guerre de basse intensité dont il est constamment l’objet, par certains partisans, élus, proches et alliés du gouvernement précédent. Avec beaucoup d’élégance, il a fait droit à la requête de financement des projets, activités et réjouissances populaires que veulent réaliser les sénateurs de ce département, pour leur propre visibilité, à l’occasion de cette célébration. L’opposition publique, si ce n’est l’hostilité manifeste, de ces derniers à mon encontre, importe peu pour l’administration Privert-Jean Charles, dans ses prises de décision.
Le Président du conseil municipal, à l’issue du te deum, invite les membres du gouvernement et les grands commis de l’Etat, au Palais municipal, pour un vin d’honneur. C’est dans ces lieux que le sénateur Latortue, bien au fait et peut-être impliqué aussi de ce qui se tramait, me glissait à l’oreille « Président, il y a un petit groupe de partisans du PHTK, qui se prépare à te chahuter au moment de ton discours. Je te le signale pour que tu ne sois pas surpris par leur action ». Merci sénateur, j’en prends bonne note.
« REZILTA, REZILTA, REZILTA, REZILTA »
Le maître de cérémonie, une fois, campé le symbolisme de cet important anniversaire qui réunit, tant de dignitaires haïtiens et étrangers, sur la place d’armes des Gonaïves, m’invite, en ma qualité de chef de l’Etat et président de la République à gravir la tribune pour le message du jour.
Je me suis, à peine, mis debout pour avancer vers la tribune qu’un groupuscule tel que le sénateur Latortue me l’avait annoncé, se met à tue-tête à vociférer, « Rezilta, rezilta, rezilta, rezilta ». Il s’agit, selon les informations reçues d’une honteuse manipulation de certains membres, d’organisations populaires, réputés proches de Jovenel Moise par un très honorable sénateur du département, pour m’intimider et m’empêcher de délivrer mon message de circonstance, à l’occasion de cette traditionnelle célébration
REZILTA, REZILTA, REZILTA, de quoi s’agit-il ?
Le conseil électoral provisoire, comme prévu dans le calendrier électoral, a publié les résultats préliminaires du premier tour des élections du 20 novembre 2016. Monsieur Jovenel Moise est classé en première position. Les candidats qui se sont estimés lésés par lesdits résultats, ont formulée leurs réserves et introduit leurs recours au bureau du contentieux électoral national (BCEN) en utilisant les voies tracées par le décret électoral. Cette étape est indispensable et préalable à la proclamation des résultats définitifs.
C’est un crime de lèse-patrie. Manipuler, et mentir à, de simples gens, pour la plupart pauvres d’esprit pour les porter à saboter un événement aussi important que la célébration de l’anniversaire de l’indépendance nationale, ne fait pas honneur à des hommes qui prétendent occuper des fonctions (sénateur et président) au plus haut sommet de l’Etat. Ces résultats que Jovenel Moise, à travers un sénateur, pousse ses partisans à réclamer, n’étaient même pas, encore, établis par le conseil électoral provisoire, voire à être transmis à l’Exécutif pour sa publication au Moniteur, journal officiel de la République.
Je ne suis pas homme à se laisser faire et à fuir devant ses responsabilités. Avec la force de caractère, qu’on me connait, j’ai puisé l’énergie nécessaire pour affronter courageusement cette adversité. Le ton était si haut qu’ils ont dû arrêter avec leur vocifération et se retrouver même à applaudir des passages de mon discours. A la fin de la cérémonie, j’ai descendu de la tribune, pour me faufiler parmi la foule et serrer les mains de ceux-là même d’il y a quelques minutes étaient déployés pour semer le trouble et le désordre. Tout est bien qui finit bien.
Nous voici rassemblés sur l’esplanade historique des Gonaïves pour commémorer l’une des dates les plus significatives de notre éphéméride nationale, au motif, qu’elle nous donne à célébrer simultanément deux événements majeurs de notre vie de peuple.
Le premier, commun à la plupart des cultures de l’Occident chrétien, carillonne l’avènement de l’An Nouveau, porteur de nos espoirs, de nos ambitions, des promesses comme de nos appréhensions de l’avenir. Le second nous est propre ; elle célèbre la naissance de la Nation haïtienne, la déclaration de notre indépendance en tant que peuple.
Je noterai également que depuis 50 ans, les Nations Unies ont ajouté une dimension extraordinaire à cette date déclarée depuis 1967 Journée Mondiale de la Paix. Et cette année, la Pape François a signé, depuis le 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception considérée par le monde catholique comme la Reine de la Paix, son Message dédié à la non-violence, en conviant toutes les nations de la planète « à construire un monde libéré de la violence, premier pas vers la justice et la paix ».
Si donc le Premier-Janvier, dans le calendrier solaire, julien et grégorien, ouvre le livre des saisons et des jours que la main de Dieu tourne, page après page, pour orienter le destin de l’humanité, au seuil du XIXe siècle, survenait le miracle haïtien: des hordes de va-nu-pieds coupaient de leur sabre indigène le fil de l’histoire colonialiste et esclavagiste et inscrivaient le Premier janvier au frontispice d’un nouvel ordre mondial de liberté, d’égalité e de fraternité pour tous les êtres humains. Et il ne me paraît pas sans intérêt de noter ici que cette place que nous revendiquons dans la construction du monde moderne trouve une illustration dans une courte phrase du message de félicitation adressé au peuple haïtien par le Président Barack Obama : « Haïti, écrit-il, a une place historique dans le combat partagé pour l’indépendance de l’Hémisphère occidental ».
Mes chers Compatriotes,
Au cœur de cette place brûlée de soleil et de ferveur, chaque Haïtien, chaque Haïtienne devrait ressentir le souffle puissant des Pères fondateurs qui proclamèrent ici même et signèrent à l’encre de leur sang versé l’Acte de l’Indépendance nationale pour que nous, leurs héritiers, puissions vivre dignes, libres et souverains.
En dépit des accidents de notre histoire qui nous valurent des humiliations inexpiables, la date du Premier-Janvier se charge pour nous d’une densité particulière d’émotions et de sentiments. A travers les aspérités du chemin parcouru, que ce soit sur les sentiers des saisons et des jours de l’année qui s’en va, que ce soit sur les grandes avenues tracées sous nos pas, des fois chancelants, par les sublimes ambitions et visions de nos Aïeux, le Premier-Janvier nous retrouve chaque année à ce pèlerinage du cœur et de l’esprit, au temple authentique des Gonaïves, le pôle de toutes les convergences patriotiques où nos Ancêtres, pour des raisons évidentes, ont choisi de poser la première pierre de l’Edifice national.
Cela ne servirait à rien de vous rappeler, en cette circonstance de communion nationale, les prouesses de nos Ancêtres, sans exalter les sacrifices qu’ils ont consentis pour nous libérer du joug infernal de l’esclavage. Retenons surtout la leçon qu’ils nous lèguent et dont nous devons nous inspirer chaque jour pour renouer avec le fil de notre existence de peuple marqué par le destin. Sans le pardon mutuel et l’Unité des Noirs et des Mulâtres, la proclamation de l’Indépendance d’Haïti eût été un rêve impossible, un projet improbable, condamné au sort désastreux de la flambée révolutionnaire menée par Spartacus dans l’antiquité romaine.
Mes chers Compatriotes,
Depuis 213 ans, notre pays est confronté à un ensemble de défis et de contraintes qui ne devraient point effrayer les descendants des titans de 1804. Nous sommes toujours incapables de nourrir notre population, d’éduquer nos enfants, d’assurer des soins de santé à nos compatriotes ou de construire les infrastructures nécessaires au développement économique de notre pays. La liste serait trop longue et la journée trop courte pour une déclinaison exhaustive de nos besoins. Nous avons déjà essayé une large panoplie des formes de gouvernement, et pourtant nous avons dégringolé, au fil des décennies, du statut de « perle des Antilles » à l’étiquette honteuse de « pays le plus pauvre des Amériques ».
Konpatriyòt mwen yo,
Mwen ta renmen nou fè yon ti reflechi e mande tet nou pou ki rezon peyi nou nan eta sa a. Nou se moun tankou tout pèp sou latè. Nou ka chita ansanm pou nou pale e deside ki sa nou vle… Men kisa ki anpeche nou fè dyalòg, youn pale ak lot pou nou byen konnen ki sa nou vle pou peyi nou an?
Jodi a mwen pa gen entansyon bay pèsonn moun leson. Nan kalfou peyi a ye, yon fason kou yon lòt, nou chak responsab. Nou oblije antann nou, fè meyakoulpa pou nou vanse. Nou tout se AYISYEN. Nou dwe aksepte ak imilite ke chak grenn Ayisyen gen kontribisyon pa yo yo ka pote nan chache solisyon pou pwoblèm nou yo. Okenn moun, okenn sektè pa ka pretann li ka rezoud pou kont li chay pwoblèm peyi Dayiti ap pote sou do l yo depi lontan.
Nou pa bezwen dakò sou tout bagay. Men nou ka antann nou sou kek gwo priyorite pou peyi a. Tankou :
a) tout timoun dwe ale lekòl !
b) fòk jèn nou yo ki fini lekòl klasik yo ka jwen bon jan fòmasyon nan nivo pwofesyonèl ak inivesitè;
c) tout manman dwe jwenn swen pou yo menm ak pitit yo;
d) fòk pwoteksyon sosyal blayi pou klas ki pi defavorize yo;
e) fòk gen plis travay ki kreye nan peyi a.
f) Kidonk nou dwe garanti sekirite ak estabilite politik pou moun ki gen kob ka envestí nan peyi a pou kreye job ak richess.
g) Leta dwe sispann konte sou èd lòt peyi chak fwa ke syklon ak gwo lapli pote inondasyon nan yon zòn;
h) fòk tout timoun, tout granmoun ka jwen la swenyay san yo pa blije al plane ti kras byen yo reyisi genyen depi maladi frape yo.
i) Fok nou kreye yo demen chaje avek lespwa pou jen, pou yo sispan riske lavi yo nan lanme ak nan frontye lot peyi pou yo ale chache yon lavi miyo.
Eske gen yon pati politik, genn yon kandida ki pa dakò ak priyorite sa yo? Pou ki rezon nou pa ka antann nou sou yo? Ki diferans sa fè si se yon lòt prezidan ki pèmèt desantralizasyon fèt tout bon vre, depi moun kap viv nan vil pwovens yo ak nan kominote riral yo jwenn sèvis ke leta dwe yo e ki pa janm egziste depwi 213 lane ?
Pèp ayisyen,
Se pa nan eleksyon nou te votem pou Prezidan ki fe mwen nan Palè nasyonal, kom Prezidan. Kidonk mwen pat fè nou okenn pwomès kanpay. Se Palman an ki te sèvi ak Konstitisyon an, manman lwa peyi a, pou jwenn yon solisyon ki te pèmèt peyi a evite gwo latwoublay sosyal ak politik. Palmante yo te banm yon sel misyon. Fe eleksyon pou nou kaba ak kriz ak enstabilite ki se de gwo kanse ki anpeche peyi a fe pwogre. Mwen te angagem poum ranpli misyon sa ak tout kè m, ak tout detèminasyon m. Rèv mwen pou Ayiti cheri, se menm rèv sa ki nan kè tout Ayisyen pou peyi yo :
– Wè Ayiti tankou tout peyi sou latè k ap vanse, k ap pwospere nan byennèt tout moun;
- Gen enstitisyon djanm ki ka ede nou konstwi yon peyi stab nan pwogrè ak devlopman.
Haïtiens, Haïtiennes,
Différentes personnalités et organisations de la communauté internationale, à titre de vœux pour cette nouvelle année 2017 et pour la célébration des 213 ans de notre indépendance, nous ont adressé messages de félicitations. Nous retenons que tous ils ont tourné autour de la nécessité pour nous haïtiens et haïtiennes de trouver à travers le pardon, l’unité, la réconciliation et le dialogue, la réponse aux maux qui freinent le développement de notre pays. Ces exhortations sont clairement exprimées tant dans la note publique de la Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies Madame Sandra Honore qu’à travers l’homélie prononcé, par Monseigneur Yves Marie Péan à l’occasion du Te Deum spécial tenu à la Cathédrale du Souvenir dans la Ville des Gonaïves.
Mes très chers Compatriotes
Fonctionnaires de carrière, j’ai pendant des années servi mon pays avec loyauté, dévouement et patriotisme. Je n’ai eu à commettre aucun crime dans l’exercice des différentes fonctions que j’ai eu le privilège d’assumer. Pourtant, pour des raisons inavouées et inavouables, j’ai passé plus de deux longues années de ma vie en prison pour des faits dont leur existence même m’est inconnue. Victime de persécutions politiques, j’ai connu des déboires inutiles et injustifiés ou même ma vie était en danger. Toutes les conditions étaient donc réunies pour faire germer dans mon cœur des sentiments légitimes de haine, d’aigreur, voire de vengeance contre mes accusateurs et pourfendeurs. Ces compatriotes, avec qui j’entretenais d’excellentes relations de collaboration et d’amitiés, ont voulu, à travers ces accusations mensongères et injustes, salir mon nom, mon image et ma réputation.
A ma sortie de prison, en juin 2006, suite à cette ordonnance opportune et courageuse, prise ici même dans cette ville des Gonaïves, par un collège de juge présidé par le très regretté et intègre juge Me Hugues St Pierre, dont je salue la mémoire. J’ai alors vite compris que, pour l’amour de mon pays et le bien-être de mes concitoyens, objet de tous mes combats, je devrais pratiquer le culte du pardon et m’asseoir avec tout le monde, même avec mes anciens geôliers. Comme Joseph a ses frères, j’ai dit à l’intention de mes thuriféraires « vous avez médité dans votre cœur de me faire du mal, Dieu l’a changé en bien ». C’est justement ce séjour en prison qui m’a, dans un premier temps, ouvert les portes du Sénat de la République et plus tard celle de la Présidence.
Mes Chers compatriotes,
Le contact avec mes futurs mandants et l’immensité des problèmes à résoudre, m’ont vite convaincu que seule l’union de toutes les forces vives de la Nation permettrait d’apporter des solutions durables aux maux qui affectent notre pays et notre peuple. Nos Ancêtres l’avaient bien comprise et l’ont mis à profit pour concrétiser leur rêve d’indépendance. Aujourd’hui encore nous sommes, une nouvelle fois, condamnés à nous unir pour prendre, en main, le destin de notre pays. Cependant, il n’y a pas d’unité sans la confiance. Et pour qu’il y ait confiance il faut se connaitre et c’est par le dialogue et le pardon que nous devons commencer.
Je sais qu’il est difficile de pardonner, mais nous devons nous rappeler que sans le pardon, il n’y aurait pas eu de Congrès fondateur de l’Arcahaie conduisant à la proclamation de l’Indépendance aux Gonaïves.
Aujourd’hui, nous sommes dans une situation délicate, et probablement nos Pères, du haut de leur Olympe, nous regardent avec des yeux éjectés de reproches et de remontrances : car, des soldats étrangers se trouvent sur notre territoire à cause de nos conflits interminables. Quel que soit le niveau d’opportunité ou de nécessité de cette présence, le bilan de nos inconséquences laisse un gout amer dans la bouche de tout vrai patriote. A cet égard, la célébration de ce jour de l’indépendance ne revêtirait aucun sens, si elle n’inspirait un serment de réinsertion sur la vision des Ancêtres, si elle ne comportait un engagement réel et sincère de tous les camps de s’unir pour faire gagner Haïti!
La solidarité qui a entouré l’Exécutif, que je dirige, à l’occasion de notre décision d’assumer entièrement le financement de nos élections apporte la preuve irrécusable que chaque Haïtien, chaque Haïtienne sait oublier ses dissensions politiques pour promouvoir et supporter toutes mesures prises pour la sauvegarde de notre dignité et de notre souveraineté. Je vous annonce d’ailleurs que mon administration et le gouvernement du Premier ministre Enex Jean-Charles laisseront en héritage aux générations futures la création d’un « Fonds de financement électoral », afin de leur épargner l’humiliation sporadique de solliciter des fonds pour élire nos représentants et nos dirigeants.
Concitoyens, concitoyennes,
A la veille de remettre le pouvoir à un président élu, mes inquiétudes sur l’avenir du pays sont grandes. Mais je sais que sortir du tunnel de la pauvreté et de l’instabilité est à la portée de citoyens et de citoyennes qui cultivent au plus haut degré l’amour de la patrie commune et immortelle. Pendant mon court mandat, j’ai eu le privilège de rencontrer tous les anciens présidents de la République ; j’ai également pu converser avec beaucoup de candidats à la présidence. J’ai, d’autre part, maintenu un dialogue permanent avec la société civile et les partenaires sociaux.
J’exhorte ceux qui auront demain à mener la barque nationale à continuer ce dialogue, qui reste et demeure la clé de l’apaisement social désiré par tous, ainsi que le moteur du développement économique attendu par chaque Haïtien et chaque Haïtienne.
Peuple haïtien,
Amis de la communauté internationale,
Puisque la commémoration de l’anniversaire de l’indépendance de notre pays coïncide avec la célébration du nouvel an, je souscris avec le plus grand plaisir à la tradition de formuler des souhaits avec cette spontanéité de sincérité et de vérité qui ont toujours caractérisé mes rapports avec autrui. A vous tous, Haïtiens d’ici et d’outre-mer, Diplomates et Consuls accrédités au pays, étrangers qui ont élu domicile ou décidé de passer les fêtes dans l’enchantement du paysage haïtien, je vous adresse un cordial salut. Que les vœux les plus chers de chacun d’entre vous se réalisent au cours de cette nouvelle année 2017 !
Que Dieu nous protège tous !
Que Dieu protège Haïti.
Je vous remercie.
Le 18 novembre 1803, Jean Jacques Dessalines mène la plus grande révolution ethnico-raciale et sociale de l'histoire du monde : une révolution antiraciste, anti-discrimination et anti-ségrégation. Ce grand stratège militaire haïtien a incendié sa propre maison et a ordonné aux autres généraux de faire de même. Ce fait est entré dans les annales de l’histoire militaire et de la guerre et a été appelé « stratégie de la terre brûlée ». Elle consiste à attirer l’ennemi sur son territoire, à le priver de ressources et finalement à l’encercler. Cette stratégie réussit à faire capituler la plus grande armée d’Europe et donna naissance à la première République noire, créée de toute pièce par des personnes racisées, en janvier 1804.
Le propre gendre de Napoléon, le général Leclerc, décédé sur l'Île lors de sa dernière tentative de reconquête de l'Île contrôlée par Dessalines, lui écrivit une lettre disant : « Nous, les soldats français, étions devant eux comme des écoliers. »
Lors de l'événement, les spécialistes de la révolution haïtienne ont également souligné l'intelligence diplomatique de Jean Jacques Dessalines. L'histoire rappelle que Napoléon envoya une légion de Polonais à Saint-Domingue (aujourd'hui Haïti) pour vaincre les insurgés noirs. Certains historiens soutiennent que Napoléon aurait pactisé avec les dirigeants polonais dans le cadre de leurs luttes communes contre la Russie des tsars. En récompense de sa participation à la guerre, le monarque dut réhabiliter la nation polonaise affaiblie. En juin 1802, quelque 2 270 soldats polonais arrivèrent au Cap-Français (aujourd'hui Cap-Haïtien), alors capitale coloniale de Saint-Domingue, tandis qu'en septembre de la même année, 2 500 autres arrivèrent à Port-Républicain (aujourd'hui Port-au-Prince). Des Allemands et des Suisses se sont également retrouvés dans cette dernière. Paradoxalement, Dessalines a tous convaincu de lutter contre la France sur l'île. Dans une lettre déclassifiée du général polonais Ludwik Mateusz Dembowski, promu commandant par Rochambeau, général des armées françaises, il écrit : « J'ai eu l'occasion de rencontrer le chef des insurgés [Dessalines], étant retenu en otage depuis 24 heures. Malgré la grande sauvagerie qu'ils exprimaient généralement, ils m'ont accueilli, et malgré la grande ignorance qu'on suppose en eux, ils raisonnent à leur manière et avec justice ».
Luiz Mott, très célèbre historien, a publié une historiographie décrivant l'appréciation et l'admiration exprimées à travers divers types de manifestations en l’honneur de l'empereur haïtien Jean Jacques Dessalines dans les rues et les Quilombos (lieux de résistance des afro-descendants), surtout à Rio de Janeiro. Certains historiens affirment que « des esclaves de Rio furent arrêtés en 1805 pour avoir porté des médailles à l'effigie de Dessalines », d’autres contre-affirment qu'il s'agissait de « chèvres et milices créoles et non d'esclaves ».
Dessalines a inspiré Francisco Miranda en 1806, ainsi que d'autres dirigeants latino-américains et esclaves. Le chercheur Gabriel Di Meglo a relaté un événement très intéressant sur l'influence de la stratégie de libération de Jean Jacques Dessalines en Argentine également. Il raconte qu'en 1812, dans la province de Cuyo, des insurgés esclaves organisèrent une rébellion afin d'obtenir le dénommé “document de la liberté. Bernardo - réduit en esclavage par Francisco Aragón - était l'un des dirigeants qui co-dirigeaient le réseau des révoltés avec le Noir libre, Joaquín Fretes. Bernardo a déclaré, selon plusieurs témoins « qu'il fallait faire dans cette ville ce que [Jean Jacques Dessalines et] les Noirs des îles Saint-Domingue ont fait, tuer les blancs pour devenir libres ». Ils avaient développé d'importantes activités clandestines pour gagner des adeptes. Un ami de Bernardo déclara : "ils allaient incendier tous les riches colons, prendre leur argent et leurs chevaux".
En 1812, il inspira également le révolutionnaire cubain José Antonio Aponte. La même année, lors de la campagne de Russie mettant aux prises les Armées impériales de l'Empire russe et celles de Napoléon Bonaparte, Mikhaïl Koutouzov, général en chef de l’Armée tsariste de l’Empire russe, adopta également la « stratégie de la Terre brûlée ». Évitant jusqu'au bout l'affrontement, Koutouzov parvient à faire approcher 200 000 hommes de la Grande Armée de la ville de Moscou. Il incendia, ensuite, la ville sur ordre du gouverneur Rostopchine, privant d'abri les 200 000 hommes de la Grande Armée française pendant l'hiver. Le 18 octobre, en plein hiver russe, Napoléon était contraint de capituler.
Certains divulgateurs historiques racontent que l’Union soviétique (URSS) aurait même vaincu les nazis avec le même piège dessalinien au cours de l’hiver 1842 : la stratégie de la « Terre brûlée » avec évidemment quelques modernisations de la technique. Même un général vietnamien, Võ Nguyên Giáp, raconte en 1970 qu'il s'était inspiré de la stratégie militaire de Dessalines et que, grâce à cette dernière, ils avaient vaincu à la fois les États-Unis et la France.
"L'une des plus grandes folies que j'ai faites a été d'envoyer cette armée à Saint-Domingue (Haïti)", a regretté Bonaparte, selon son propre médecin britannique, Barry Edward O'Meara, dans son livre "Une voix de Sainte-Hélène".
Malgré le fait que Dessalines ait mis son intelligence et sa
stratégie au service de l'humanité toute entière, que ses tactiques militaires
font l'objet d'études dans de nombreux espaces académiques et militaires, il continue néanmoins de faire face à des considérations ignominieuses, aux mensonges, aux diffamations et
aux attaques du système éducatif et journalistique colonial, après la révolution, notamment par des ex-colons comme Mazères - qui défendait publiquement
l’infériorité des Noirs - pendant que Dubocra (Jean Louis) - qui décrivait et
caricaturait le libérateur des Noirs avec la tête d’une femme blanche afin
d’inciter la haine et le dégoût à l'égard des Haïtiens. Le plan de ces derniers,
entre autres, jusqu'à aujourd'hui, continue à être faire son petit chemin en raison de
l'infiltration du racisme au sein du système et des structures de notre société
traumatisée et néo-colonisée.
Par : Jackson JEAN, journaliste
2. Christophe (noir)
3. Pétion (mulâtre)
4. Clervaux (mulâtre)
5. Geffrard (mulâtre)
6. Vernet (mulâtre)
7. Gabart (mulâtre)
8. P. Romain (noir)
9. Gérin (mulâtre)
10. F. Capoix (noir)
11. Jean-Louis François (noir)
12. Férou (mulâtre)
13. Daut (noir)
14. Cangé (mulâtre)
15. L. Bazelais (mulâtre)
16. Magloire Ambroise (noir)
17. J.-J. Herne (mulâtre)
18. Toussaint Brave (noir)
19. Yayou (noir)
20. Bonnet (mulâtre)
21. F. Papalier (mulâtre)
22. Morelly (mulâtre)
23. Chevalier (mulâtre)
24. Marion (mulâtre)
25. Magny (noir)
26. Roux (mulâtre)
27. B. Loret (mulâtre)
28. Quéné (mulâtre)
29. Macajoux (mulâtre)
30. Dupuy (mulâtre)
31. Carbonne (mulâtre)
32. Diaquoi aîné (noir)
33. Raphaël Malet (blanc)
34. Derenoncourt (mulâtre)
35. Louis Boisrond-Tonnerre
[1] Raphaël Malet est néanmoins indiqué par Dantès Bellegarde comme étant « mulâtre ».
 Claude-Henri Accacia
Claude-Henri Accacia Michel Accacia
Michel Accacia Gesner Armand
Gesner Armand Jean-Claude Bajeux
Jean-Claude Bajeux Anthony Barbier
Anthony Barbier Jessy Ewald Benoît
Jessy Ewald Benoît Pierre Buteau
Pierre Buteau Jean Casimir
Jean Casimir Georges Castera
Georges Castera Suzy Castor
Suzy Castor Syto Cavé
Syto Cavé Amos Coulanges
Amos Coulanges Jean Coulanges
Jean Coulanges Magalie Comeau Denis
Magalie Comeau Denis Patrice-Michel Derenoncourt
Patrice-Michel Derenoncourt Max Dominique
Max Dominique Frank Etienne
Frank Etienne Marie-Andrée Etienne
Marie-Andrée Etienne Pierrot Exama
Pierrot Exama Enock Charles Faustin
Enock Charles Faustin Jude Charles Faustin
Jude Charles Faustin Jean-Claude Fignolé
Jean-Claude Fignolé Reynold Guerrier
Reynold Guerrier Michel Hector
Michel Hector Reynold Henry
Reynold Henry Laënnec Hurbon
Laënnec Hurbon André Lafontant Joseph
André Lafontant Joseph Frandley Denis Julien
Frandley Denis Julien Dany Laferrière
Dany Laferrière Yves Lafortune
Yves Lafortune Yanick Lahens
Yanick Lahens Ricardo Lefèvre
Ricardo Lefèvre Danièle Magloire
Danièle Magloire Jessy Manigat-Chancy
Jessy Manigat-Chancy Daniel Marcelin
Daniel Marcelin Gérard Mathieu Junior
Gérard Mathieu Junior Myriam Merlet
Myriam Merlet Jean Metellus
Jean Metellus Marc-Ferl Morquette
Marc-Ferl Morquette Jean Michel
Jean Michel James Noà« l
James Noà« l Raoul Peck
Raoul Peck Claude Pierre
Claude Pierre Michèle Pierre-Louis
Michèle Pierre-Louis Vogly Pongnon
Vogly Pongnon Emelie Prophète
Emelie Prophète Guy Régis Junior
Guy Régis Junior Jacques Roche
Jacques Roche Wooly Saint-Louis
Wooly Saint-Louis Paul Saint-Preux
Paul Saint-Preux Amilcar Similien (Simil)
Amilcar Similien (Simil) Michel Soukar
Michel Soukar Evelyne Trouillot
Evelyne Trouillot Michel Rolph Trouillot
Michel Rolph Trouillot Lyonel Trouillot
Lyonel Trouillot Gary Victor
Gary Victor
Visites du site
Citations

Join thousands of our subscribers and get our best recipes delivered each week!
POPULAR POSTS
Polls
Choix éditorial
Nombre de visites
Par sujet
Follow Us
Formulaire de contact
Citation
Popular Posts
L'île de La Navase : trésor haïtien confisqué par les États-Unis d'Amérique
Les présidents dominicains d'origine haïtienne
Lettre de remerciement du général dominicain Gregorio Luperón au président Nissage Saget
Lettre de refus d'Anténor Firmin à la demande des États-Unis d'affermer le Môle Saint-Nicolas
Haïti : la malédiction blanche
La prière de Boukman Dutty
Lettre de Jean-Jacques Dessalines au président Thomas Jefferson des Etats-Unis
Lettre de Toussaint Louverture à Napoléon Bonaparte
I have a dream : Discours historique de Martin Luther King le 28 Août 1963 à Washington
Les péchés d'Haïti