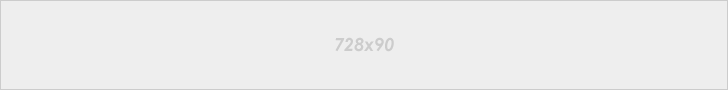Une conversation avec Eduardo Grüner par Lautaro Rivara
Comment peut-on commencer à parler d'Haïti sans commencer par la Révolution de 1804 ? Afin de nous plonger dans l'histoire fascinante du pays, nous avons eu l'occasion d'avoir une conversation agréable et prolongée avec Eduardo Grüner, spécialiste et passionné par le sujet. Grüner est un intellectuel prolifique dont l'œuvre couvre une énorme variété de sujets et de genres. Sociologue, essayiste, critique culturel. Docteur en sciences sociales et vice-doyen de la faculté des sciences sociales de l'université de Buenos Aires. Professeur d'anthropologie de l'art à la Faculté de philosophie et des arts et de théorie politique à la Faculté des sciences sociales, également dans la même université. Il est l'auteur, entre autres, des livres : Un género culpable (1995), Las formas de la espada (1997), El sitio de la mirada (2000), El fin de las pequeñas historias (2002), La cosa política (2005). Et aussi, bien sûr, de "La oscuridad y las luces" (2010), un livre classique et incontournable sur le sujet qui nous réunit.
Lautaro Rivara : La rencontre avec Haïti, que ce soit par le biais de l'essai, de la réflexion historique ou même de votre propre expérience, semble quelque peu exceptionnelle, toujours inattendue. Comment est née votre approche intellectuelle et - pour ainsi ainsi dire - empathique d'Haïti et de l'histoire de notre révolution première ?
Eduardo Grüner : J'avais une connaissance très vague, très générale de la Révolution haïtienne, et de certains aspects de la culture nationale, surtout à travers la littérature ou les études anthropologiques, mais la vérité est que jusqu'en 2004, je n'avais jamais vraiment commencé à réfléchir sérieusement à la question. À cette époque, j'étais vice-doyen de la faculté des sciences sociales [de l'université de Buenos Aires] et j'ai été envoyé à un grand congrès sur l'éducation à La Havane. J'y ai découvert une série d'activités en rapport avec le bicentenaire de l'indépendance d'Haïti et un numéro spécial du magazine Casa de las Américas consacré à la révolution haïtienne. C'est à ce moment-là que je suis devenu vraiment vorace pour en apprendre davantage. J'ai commencé à travailler, à étudier, à lire sur le sujet, plus précisément sur la Révolution. La première activité que j'ai entreprise à la suite de cet approfondissement relatif a été un séminaire virtuel dans le cadre du CLACSO, à partir duquel j'ai formulé un projet de thèse de doctorat qui est devenu le livre "La oscuridad y las luces : capitalismo, cultura y revolución" (Buenos Aires, Edhasa : 2010).
Je n'ai que de la satisfaction intellectuelle avec ce sujet : avec Haïti en général et surtout avec le sujet de sa révolution. Croyez-le ou non, je n'ai jamais mis les pieds dans ce merveilleux pays. À deux reprises, j'étais sur le point de participer à des congrès et à des activités, mais une fois, il y a eu le tremblement de terre, et l'autre fois, un énorme bouleversement politique.
L.R. : Comme vous le savez, de nombreux mythes entourent tout ce qui concerne le pays, dont beaucoup sont spécifiquement historiques et historiographiques. En ce sens, quelles étaient les idées dominantes dans votre milieu d'origine et votre milieu intellectuel sur Haïti avant que vous ne commenciez cette étude systématique de la Révolution ?
E.G. : La vérité est qu'il n'y avait pas beaucoup d'idées dominantes. Vous savez très bien - et c'est une des choses qui m'ont poussé à entreprendre ce travail - que l'on parle très peu d'Haïti, que l'on sait très peu de choses, et que cela n'est pas dû à une simple ignorance ou à un désintérêt, mais qu'il y a tout un dispositif, un échafaudage idéologique derrière la dissimulation, le déni ou l'oubli - tout cela entre guillemets - d'Haïti, de son histoire et de sa révolution. Mon intérêt intellectuel est lié à l'exploration de ce que j'appelle métaphoriquement "le côté obscur de la modernité". Dans le cas d'Haïti, cette métaphore est tout à fait littérale.
Le premier document de recherche que j'ai proposé avait trait à Haïti et à la situation dans le pays. Ceci, avec toutes les "mauvaises intentions" d'explorer efficacement la révolution haïtienne, peu connue et négligée, un événement d'une singularité absolue, dans plusieurs sens.
Dès 2004, on commençait à parler des célébrations du bicentenaire de l'indépendance à l'horizon 2010. C'est alors que je me suis rendu compte de la formidable "renégation" - comme dirait un psychanalyste - qu'il y avait à attendre 2010, comme si les premières révolutions d'indépendance avaient eu lieu en 1810, en sautant la toute première d'entre elles.
Mais la Révolution haïtienne n'était pas seulement singulière en termes chronologiques ou historiques, elle était la plus radicale, la plus profonde, la plus subversive, parce que c'était la seule révolution, au sens le plus complet du terme, où la classe sociale et l'ethnie exploitée par excellence - les esclaves noirs d'origine africaine - ont pris le pouvoir et ont fondé une nation sur ces bases.
La "renégation" de la révolution haïtienne est très symptomatique dans ce sens, car elle implique d'obscurcir, de soustraire à la vue la nature radicale d'une révolution authentique, qui est très difficile à décrire. On ne peut pas dire qu'il s'agissait d'une révolution socialiste comme celle de la Russie en 1917, ni d'une révolution exclusivement bourgeoise comme la révolution française de 1789. C'était une révolution indépendantiste, bien qu'elle n'ait pas commencé avec cette intention, mais elle a pris ce caractère au cours du processus. C'était une révolution anti-esclavagiste. Et c'était aussi une révolution culturelle au sens le plus strict du terme. Il m'a semblé alors que cette énorme singularité avait beaucoup à dire sur la façon dont la modernité et son idéologie avaient été construites. Parce que cette idéologie, clairement eurocentrique, a été construite sur la base de la modernité, une invention occidentale, qui a ensuite été exportée vers ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, vers la soi-disant périphérie du système mondial. Mon hypothèse, la thèse centrale de mon travail, est que la modernité est en fait une "coproduction" entre l'Europe et ses colonies, certainement en des termes loin d'être symétriques. Une "coproduction" dans laquelle une partie a mené la barque, mais qui n'aurait pas pu devenir la puissance hégémonique qu'elle était sans ce que la main-d'œuvre esclave des Caraïbes lui a apporté dans ce cas. Ce qu'on appelle aujourd'hui, par euphémisme, la "gobalisation", un fait qui n'a rien de nouveau pour nous, puisqu'il a commencé en octobre 1492.
L.R : Vous donnez des indices très clairs sur la raison pour laquelle Haïti a été en quelque sorte délogé de l'imaginaire occidental. D'autres auteurs ont également donné un aperçu du caractère traumatisant de la révolution haïtienne pour l'Occident. Il y a même ceux, comme l'historien Michel-Rolph Trouillot, qui la décrivent comme un "événement impensable" dans les termes de son époque. Mais vous étendez maintenant votre préoccupation à la question de savoir pourquoi le pays a également été écarté de la mémoire des propres forces progressistes, de gauche et intégrationnistes de la région, alors que ce sont ces dernières qui ont célébré avec le plus d'enthousiasme leurs bicentenaires respectifs.
E.G. : Je pense qu'il faut l'attribuer à des facteurs idéologiques profondément ancrés en chacun de nous. Il est vrai, comme vous le dites, que c'est certainement beaucoup moins le cas pour les autres révolutions d'indépendance, dont nous sommes généralement très conscients. Ensuite, bien sûr, il y a tous les débats sur ces soi-disant révolutions : dans quelle mesure l'étaient-elles ou simplement des changements d'élites ou de castes dirigeantes ? C'est la différence radicale avec le cas haïtien, comme nous l'avons dit. Il ne s'agit pas seulement d'un changement des élites, mais d'un changement de la classe sociale qui prend le pouvoir. Cela peut servir à formuler une hypothèse par rapport à votre question, car en 2010, ce que mon ami Nicolás Casullo appelait " l'imaginaire de la révolution " était depuis longtemps abandonné, même dans la pensée progressiste, à l'exception de certains secteurs plus radicalisés et minoritaires de la gauche. D'une certaine manière, la perte de cet horizon devient rétroactive, projetée en arrière. Il est vrai que les révolutions d'indépendance se sont généralisées après 1810. Ainsi, dans ce contexte mental - pour ainsi dire - cet événement unique et "prématuré" a été semi-oublié ou pas du tout pris en compte.
L.R. : En relisant les conclusions de votre livre, et en pensant à Haïti à travers le tamis du roman d'Andrés Rivera "La revolución es un sueño eterno", je me suis souvenu de cette phrase que Rivera met dans l'interminable soliloque de Castelli, quand il dit : "si nous sommes vaincus, qu'importe ce qu'on dit de nous ?" Je sais que vous avez pris part à ce débat historique, qui est aussi évidemment politique, sur la question de savoir si la révolution haïtienne était une "révolution vaincue" ou une "révolution ratée", et si elle a impliqué et laissé une sorte d'héritage durable. Ceci en réponse à certaines approches, à mon avis terriblement cyniques, qui finissent par certifier la "parfaite futilité" de la révolution haïtienne, et par extension de toute autre, encore plus après la chute du mur de Berlin. Quelle est votre évaluation, en ces termes, du processus historique haïtien ?
E.G. : C'est toute la question de ce qu'on a appelé "l'échec" de la révolution. Nous devons essayer de comprendre ce que cela signifie. Si je parle d'"échec", c'est différent de si je parle de "défaite", de "trahison", ou de toute autre épithète pouvant être utilisée pour décrire ces événements. Pour plaisanter, je dis toujours que lorsque les gens me parlent d'échec, je me souviens de deux phrases, provenant par coïncidence de deux grands intellectuels américains. L'un d'eux est de William Faulkner, lauréat du prix Nobel de littérature, qui, dans une célèbre interview, a déclaré à un journaliste : "Ne pensez pas qu'il est si facile d'échouer. J'ai eu du mal au début, puis je suis devenu de plus en plus doué". Et l'autre est d'Orson Welles, qui a dit : "J'ai commencé au sommet et j'ai dû travailler dur pour arriver en bas". Ces phrases m'intéressent car elles mettent l'accent sur le processus, l'effort, et non, de manière fétichiste, sur le résultat "final".
Maintenant, quand on parle de legs, il me semble que l'accent devrait être mis là. Sur cet événement "impensable" - vous avez cité Trouillot - sur ce traumatisme énorme, inimaginable à l'époque : sur le fait que quelques esclaves africains dépenaillés et armés de machettes ont vaincu l'armée internationale de Napoléon Bonaparte, incapable de réprimer la Révolution. Pourtant, l'impensable s'est produit. Et cela signifie que cela peut se reproduire. Et que peut-être, la prochaine fois, cela "échouera mieux". Ou ne pas échouer et en fait "réussir". Dire qu'une révolution a échoué ou a été vaincue ne devrait pas immédiatement impliquer que les raisons pour lesquelles cette révolution a été faite étaient mauvaises ou ont disparu. On pourrait plutôt penser l'inverse : que, précisément parce que cette Révolution a échoué ou a été vaincue, les raisons qui l'ont générée sont plus valables que jamais, considérant que ni l'exploitation de classe, ni l'exploitation de genre, ni la faim, ni les guerres n'ont disparu.
Donc, oui, cette révolution particulière a échoué, mais pas parce qu'elle était destinée à échouer, mais parce que le "monde" a fait tout ce qu'il pouvait pour qu'elle se produise. Nous savons qu'après la conquête de l'indépendance, l'histoire politique d'Haïti a été assez désastreuse : la division entre différents pays avec différents gouvernements, puis le désastre économique, qui a beaucoup à voir avec le fait que les Français ont imposé, afin de rétablir les relations commerciales avec l'Occident, le paiement d'une "indemnité" qui a ruiné le pays et n'a été payée qu'au milieu du XXe siècle.
Il y avait sans doute aussi des raisons internes, des erreurs, toutes sortes de facteurs intrinsèques, mais il y avait surtout ce que j'appelle dans le livre, de manière un peu métaphysique, une gigantesque revanche du monde occidental sur cet événement impensable. Aujourd'hui, on a perdu la dimension de ce qu'Haïti a généré à ce moment historique, déclenchant une véritable vague de panique, de terreur paranoïaque dans le monde entier, mais surtout dans les puissances coloniales. Un événement qui avait un nombre énorme d'autres significations, notamment philosophiques, culturelles, littéraires et artistiques, qui ont également été largement niées, cachées, marginalisées et ignorées.
L.R : Je pense aussi à des héritages qui sont peut-être plus internes à la nation haïtienne, dans des processus qui sont plus difficiles à réfléchir et à analyser depuis l'extérieur du pays lui-même. Par exemple, le fait qu'il s'agisse du seul pays où la culture des esclaves, la langue des esclaves, la religion des esclaves et la forme d'organisation productive sont aujourd'hui celles de la nation haïtienne dans son ensemble : je fais référence au marronnage, au créole, au vaudou et au lakou paysan. Quand on analyse les contradictions et les apories de la situation coloniale en général, et des peuples afro-américains en particulier, j'ai le sentiment qu'Haïti a offert des réponses tenaces à toutes ces contradictions, et de manière très positive, au-delà de la défaite politique face à des corrélations de forces très défavorables. Il faudrait, par exemple, étudier le fameux article 14 de la constitution de Dessalines - dont nous avons parlé avant de commencer - où Haïti a proposé une manière sui generis de "résoudre" la question du racisme, comme aucun autre processus ne l'a fait jusqu'à présent. Parlons-en, si vous le voulez bien, un peu de cela.
E.G. : C'est une autre révolution gigantesque dans la Révolution, à additionner. Je n'ai pas non plus rencontré beaucoup d'analyses strictement constitutionnelles, de juristes ou d'historiens du droit, qui se soient concentrées sur cette Constitution [de 1805] dans laquelle figure l'article 14, qui comporte les deux lignes les plus spectaculaires et les plus "étranges", même si l'ensemble de la Constitution mérite d'être étudié.
Le célèbre article 14, qui a disparu dans les constitutions ultérieures, stipulait qu'"à compter de la promulgation de la présente Constitution, tous les citoyens haïtiens, quelle que soit la couleur de leur peau, seront appelés Nègres". Comme si cela ne suffisait pas, un article ultérieur a ajouté que les dispositions de l'article 14 seraient valables même pour les Allemands et les Polonais. Il y a une explication à cela : lorsqu'en 1802, Napoléon Bonaparte a envoyé une énorme armée pour réprimer la révolution haïtienne, il s'agissait d'une armée multinationale, qui comprenait un bataillon d'Allemands et de Polonais qui, lorsqu'ils sont arrivés et ont vu ce qui se passait là-bas, ont déserté et changé de camp. Une fois la Révolution triomphante, ils ont décidé de rester, car la guillotine ou quelque chose comme ça les attendait chez eux. La Constitution leur a donc accordé en contrepartie tous les droits de la citoyenneté, mais ils étaient désormais considérés comme des "Noirs".
Donc, à partir de 1805, également de l'autre côté de l'île, en République dominicaine, noir signifie haïtien. Malgré le fait qu'il y ait des Dominicains noirs, comme nous le savons bien. Cette universalisation de la couleur noire répond à sa négation antérieure. Dire "désormais, nous sommes tous noirs" était comme une gifle ironique aux prétentions de la Déclaration des droits universels de l'homme et du citoyen de la Révolution française, qui n'atteignaient pas les esclaves des colonies. En d'autres termes, cette universalité présumée de la déclaration avait une limite très particulière : à tel point qu'elle excluait même délibérément une couleur, le noir. Parce que la révolution haïtienne, en 1791, a éclaté essentiellement à cause de cela, parce que les nouvelles de cette déclaration ont commencé à arriver, et alors les esclaves ont dit "maintenant nous sommes libres", mais ce n'était pas comme ça. Il y avait un élément très matériel pour le nier, le travail des esclaves fournissant à la France un tiers de ses revenus. Puis vient cette gifle qui dit que nous, qui étions le "particulier" qui ne rentrait pas dans "l'universalité" de la déclaration, devenons maintenant l'universel en affirmant que "tous sont noirs".
Depuis la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle, lorsque la colonie est passée aux mains des Français - avant cela, elle faisait partie des colonies espagnoles - les Français, avec leur esprit cartésien, classificateur, si précis, avaient cru pouvoir identifier 126 nuances de noir différentes, du "nègre nègre nègre" aux mulâtres plus clairs, etc.
L.R : Je dirais même qu'il s'agit d'un héritage durable, car j'ose dire qu'en Haïti, le racisme tel que nous le connaissons - non pas qu'il n'y ait pas de formes endogènes de racisme, étant donné que les élites noires et surtout mulâtres l'ont historiquement pratiqué - est absolument incomparable à ce que nous connaissons dans nos pays. Pour une raison très simple : si l'on s'en tient à la définition classique du racisme - par des auteurs comme Oliver Cox ou Eric Williams - et qu'on le comprend comme une manière d'organiser et de discipliner la main-d'œuvre, la "ligne de couleur" n'organise pas ici l'univers du travail. Noirs sont les travailleurs, les masses appauvries, noirs sont l'oligarchie haïtienne et la classe politique, les bourgeois, les prolétaires, et ainsi de suite. Dans le langage populaire, ni le noir ni le blanc ne désignent une catégorie strictement raciale, mais plutôt une catégorie nationale : le noir est synonyme d'Haïtien et le blanc d'étranger. Et il est très difficile de sortir de notre cadre idéologique pour entrer dans cette réalité.
E.G. : C'est très intéressant, car cela continue à démontrer la singularité de la société, de l'histoire. Il s'agit également d'une question extrêmement complexe, qui a connu, pour autant que je sache, plusieurs rebondissements. Car d'une part, une autre des hypothèses du livre est que c'est là que naît la revendication du concept de négritude : la révolution serait le grand précédent sur lequel s'appuieraient plus tard Aimé Césaire et Fanon lui-même. Des penseurs révolutionnaires qui, dans la première moitié du 20e siècle, vont provoquer un scandale et une série de débats très forts en Europe - et spécifiquement en France - avec le concept de "négritude".
Mais aussi ce concept de négritude - démontrant que ces "couleurs" expriment des relations sociales et de pouvoir - a été utilisé par la dictature fasciste de [François] Duvalier, de manière totalement pervertie, par lui et son fils Jean-Claude. C'est là qu'apparaît la revendication de la négritude comme élément oppressif, contre une partie des noirs et contre les mulâtres qui avaient historiquement un statut social plus élevé. Donc, ce "populisme" d'extrême droite de Duvalier renverse artificiellement la situation.
Tout ce que déclenche la question de la négritude est extrêmement complexe et présente ce grand intérêt que vous dites : celui d'être la seule société, dans ce cas sur le continent américain, où l'on a tenté de traiter symboliquement [la question raciale] de manière aussi radicale.
L.R. : Je voudrais vous poser une question sur deux phénomènes que nous ne pouvons pas séparer de ce phénomène révolutionnaire ou de tout autre : la question du leadership et la question de la violence. Vous avez une image que j'ai trouvée très belle et significative, lorsque vous parlez de la violence comme d'un "symptôme déchiré" exprimé par les sujets coloniaux. Je voudrais aussi vous interroger sur une contradiction : le leadership canonisé est celui de Toussaint L'Ouverture, au moins depuis "Les Jacobins noirs" [de C.L.R. James]. Mais en Haïti, ce que nous voyons, c'est que les leaders canonisés par l'historiographie européenne ou même latino-caribéenne ne sont pas les principaux référents du peuple haïtien, Jean-Jacques Dessalines étant le "père" incontesté de la patrie haïtienne, et il y a même d'autres sujets qui suscitent une énorme sympathie, comme Capois-La-Mort. Mais pas autant que Toussaint.
E.G. : Je vous demande, pourquoi ?
L.R : Je pense que c'est parce que la phase la plus radicale du processus a été dirigée par Dessalines, qui est celui qui complète le programme historique de la Révolution. Je dirais qu'il y a une question de processus d'identification par rapport à ce que vous avez mentionné sur l'auto-organisation des masses. Toussaint exprimait encore quelque chose de similaire ou d'équivalent à ce que les élites indépendantistes blanches-créoles étaient pour les pays d'Amérique latine. Ceci est très présent dans l'identification empathique et je dirais même émotionnelle avec Dessalines. Je pense que l'identification de Toussaint comme un leader incontesté et en quelque sorte "acceptable" est très imprégnée par le travail de James. Et aussi par le fait de la violence, par cette relation qui a fait de Dessalines un personnage barbare, sanguinaire et violent. Je voulais donc vous demander quel est le rôle de la violence dans un processus présentant ces caractéristiques ? Si, comme vous l'avez dit, la révolution a été déplacée, la violence a-t-elle également été déplacée ?
E.G. : Je trouve ce que vous dites sur Toussaint et Dessalines très intéressant. En effet, le poids de l'interprétation de James a été très fort. C'est un livre extraordinaire, cela ne fait aucun doute, fondateur à bien des égards, mais j'aurai l'audace de relever, le côté symptomatique de cet eurocentrisme dont nous parlions, le titre même de l'ouvrage : " Les Jacobins noirs ". Inconsciemment, James essaie d'assimiler la Révolution haïtienne à la Révolution française, et d'assimiler Toussaint à Robespierre ou Saint-Just, comme s'ils étaient comparables. Je me rends compte maintenant que c'est bien Dessalines qui représente cet autre élément bien mieux que Toussaint. Concernant l'autre question : la révolution haïtienne a été un processus d'une énorme violence. Il existe une extraordinaire trilogie allusive, trois épais volumes d'un historien et romancier américain, qui, lorsqu'il s'agit de la description des batailles - sur lesquelles l'homme est très bien informé et documenté - devient presque insupportable à lire. Car les extrêmes de cruauté qui pouvaient être atteints des deux côtés dans cette guerre révolutionnaire étaient épouvantables, sans que je cherche à construire une théorie des "deux côtés". Pour dire les choses simplement : il y avait un côté qui avait raison et un autre qui avait tort : je ne fais donc pas de comparaison dans ce sens.
Mais c'était une révolution très violente. Peut-être, en termes proportionnels et comparatifs, la plus violente de toutes les révolutions modernes : ni la française, ni la russe, ni la cubaine - ni même la chinoise - n'ont pris cette proportion de vies et n'ont atteint les extrêmes de violence que la révolution haïtienne a fait. La révolution est un événement violent, ou l'a toujours été historiquement. C'est une chose à laquelle nous devons nous résigner, car il est très difficile pour une classe dirigeante de se résigner pacifiquement, simplement parce qu'on le lui demande ou parce que la majorité le souhaite, à perdre ses privilèges, ses biens et tout ce que le fait d'être à cette place signifie matériellement, politiquement et symboliquement. La violence révolutionnaire doit-elle donc être condamnée ? Eh bien, je ne pense pas que nous puissions parler en termes de condamnation. Au contraire, il faut le déplorer.
Je me souviens de quelque chose que [Jean-Paul] Sartre a dit à propos de la révolution algérienne, à savoir que l'un des pires crimes que l'on puisse attribuer aux Français est d'avoir forcé les Algériens à être aussi violents, comme Fanon semble le célébrer dans "Les damnés de la terre". Je dis "apparemment" parce qu'il ne s'agit pas d'une célébration : il parle de la tragédie de quelqu'un qui est obligé de tuer pour être libre. Ce n'est pas que lorsqu'on parle de la violence, on la célèbre, on l'encourage. Au contraire, vous vous lamentez qu'il y ait des gens qui doivent en arriver à de telles extrémités pour, comme le diraient les Français eux-mêmes, faire valoir leurs "droits naturels".
L.R. : J'aimerais vous poser une question de projection politique, parce que si nous entrons dans l'histoire et le passé, ce n'est pas dans l'intérêt des antiquaires. Dans votre livre, vous avez un excursus philosophique avec une série de conclusions, dans lequel vous établissez un dialogue critique avec les perspectives multiculturalistes, avec certaines approches post-coloniales clairement eurocentriques - vous faites une certaine démarcation au sein de ces courants - et avec ce que nous appellerions aujourd'hui génériquement la politique de la différence en général. La question est de savoir, à partir de cet excursus et de ce débat, si votre étude de la révolution haïtienne vous permet de tirer - pour ainsi dire - des leçons ou des enseignements pour réfléchir à des problèmes aussi variés que la race, la violence, le colonialisme ou l'identité.
E.G. : Tout d'abord, une précision que je trouve toujours nécessaire de faire, à savoir la distinction entre l'eurocentrisme et ce qui est eurocentrique. Sinon, il est trop tentant, et ce serait appauvrissant, de tomber dans une sorte de "latino-américano-centrisme" - ou "haïtiano-centrisme" dans le cas présent - qui ne serait rien d'autre que de se mettre au même endroit depuis le côté opposé, comme dans une relation spéculaire. Il me semble que le plus intéressant est de s'installer dans ce lieu de tension, de conflit souvent insoluble, entre la pensée européenne et la pensée latino-américaine, car on ne peut nier que nous venons aussi de là, que finalement 500 ans d'occupation coloniale ont aussi laissé des traces dans la culture.
Mais, d'autre part, il s'agirait de voir que cette culture européenne qui nous a tant influencés et imprégnés, tout comme ce que nous disions de la Modernité, s'est aussi largement construite sur la colonialité de la connaissance, comme dirait [Aníbal] Quijano. Nous avons mentionné les conséquences philosophiques et culturelles du processus, et il y a le travail de Susan Buck-Morss ["Hegel et Haïti"], où elle montre que la "Phénoménologie de l'esprit" de Hegel, et pas par hasard la soi-disant quatrième section sur la dialectique du maître et de l'esclave, est inspirée par la Révolution haïtienne, qui se déroulait au même moment où un Hegel très attentif écrivait.
Il y a là un va-et-vient et une tension qui montrent que ce que l'on appelle souvent le multiculturalisme, par exemple, et pire encore si on l'appelle ainsi pour le célébrer tel qu'il existe aujourd'hui - si tant est qu'il existe - passe souvent sous silence les rapports de force qui se cachent derrière la prétendue "hybridité", une expression qui, je dois l'avouer, m'agace vraiment. Je préfère ceux qui parlent de métissage, car implicitement au moins, ce mot a derrière lui la reconnaissance de la violence sexuelle et du viol. Parce que le métissage historique - en Haïti, c'est très clair - a été produit par le viol de femmes noires ou indigènes par des hommes blancs. Lorsqu'on parle de multiculturalisme et qu'on le célèbre, on peut célébrer la coexistence de différentes cultures, la diversité des langues, des religions, etc. Mais pour autant que l'on tienne compte en même temps de leur origine, de la manière dont ces "différences" sont apparues. Parce que la différence est une chose, l'inégalité en est une autre. Je suis, en termes théoriques, un questionneur militant de ces idées que, pour les étiqueter rapidement, je qualifierai de postmodernes, célébrant et exaltant toutes sortes de différences pour le bien de la différence elle-même. Je pense que la première étape consiste à identifier les relations de pouvoir, de domination, d'exploitation et d'exclusion qui se cachent derrière ces différences. Et je pense qu'il est nécessaire de rester dans l'esprit sain d'une dialectique négative, comme le dirait Theodor Adorno, un auteur eurocentrique dont la pensée est utile pour réfléchir à l'eurocentrisme. Cette tension, ce va-et-vient permanent dans le cadre de cette dialectique négative, me semble être la position à partir de laquelle on peut au moins essayer de ne pas perdre de vue toute la violence symbolique et matérielle dont nous avons parlé.
D'autre part, je crois que ce problème d'identité est quelque chose qui se définit à la volée, à chaque instant, si tant est qu'il puisse être défini. Cela ne signifie pas que dans certaines circonstances, comme dans une révolution anticoloniale ou antiraciste, on ne peut pas se concentrer sur cette identité, qui est largement "artificielle", dans ce que Gayatri Spivak a appelé "l'essentialisme stratégique". Mais vous savez que vous le faites dans un but précis, qui est de défendre votre place. Lorsque cela aura été reconnu, vous passerez à autre chose. C'est un moment nécessaire dans le processus. Mais c'est un processus, ce n'est pas une ontologie.
__________________
Entretien publié en espagnol sur http://alainet.org
« Haití, más allá de los mitos » numéro 553, août 2021.
Traduction : Julie Jaroszewski












.jpg)




.svg.png)